
Date
5 juin 2024
Par
Henri de la Motte Rouge
Attaque Réputationnelle : quel Droit de Réponse ?
Partager
“Il faut 20 ans pour construire une réputation et cinq minutes pour la détruire”. À l’heure du tout numérique, ces mots de Warren Buffett n'ont jamais semblé aussi pertinents. Pour les entrepreneurs comme pour les particuliers, protéger sa réputation dans les médias et sur Internet est devenu un enjeu central. Pour les premiers, le risque est de voir leur clientèle s’évaporer. Une étude a ainsi démontré que lorsqu’un consommateur lit un avis négatif sur un produit, la probabilité d’achat diminue de 51 %. Pour les seconds, les répercussions sur la sphère professionnelle et personnelle peuvent être désastreuses. Diffamation sur Internet, publication de faux avis négatifs, vous devez agir vite, notamment en utilisant votre droit de réponse en cas d’attaque réputationnelle. Le cabinet d’avocats Touati La Motte Rouge vous propose un point complet à ce sujet.
Qu’est-ce qu’une attaque réputationnelle ?
Une attaque réputationnelle est une action visant à nuire délibérément à la réputation d'une personne, d'une entreprise ou d'une organisation. Ces atteintes sont perpétrées à travers la diffusion d'informations négatives, fausses ou trompeuses.
Cette démarche peut inclure la propagation de rumeurs, la diffamation, ou la publication de critiques infondées. Leur but est de dégrader l'image publique de la cible et d'influencer la perception d'autres personnes à son égard.
Les attaques réputationnelles peuvent se produire dans divers contextes. Elles sont bien évidemment visibles dans les médias traditionnels (presse écrite, audiovisuel, radio). Depuis plusieurs années, on les retrouve aussi massivement sur les réseaux sociaux, parfois dans le cadre de campagnes de désinformation orchestrées. On parle alors d’une atteinte à la e-réputation d’une personne ou d’une entreprise.
Il est important de noter que toute critique n’est pas nécessairement condamnable. Il est, en effet, nécessaire de faire la distinction entre ce qui relève de la liberté d’expression et ce qui constitue une infraction.
Donner un avis négatif sur un produit ou une entreprise, par exemple, ne relève pas d’une attaque réputationnelle, mais bien d’une simple critique, si les propos :
- Reposent sur des éléments factuels précis ;
- Sont exprimés avec une certaine mesure.
Le législateur a toutefois prévu un certain nombre de limites afin de sanctionner les abus susceptibles de provoquer un préjudice. Les propos tenus dans les médias et sur Internet peuvent, dans certains cas, relever :
- Du dénigrement qui consiste en des critiques négatives visant spécifiquement à nuire à l'image d'une personne ou d'une entreprise. Citons par exemple, les commentaires sur les réseaux sociaux d'un ancien employé ou d'un concurrent à l’égard de votre entreprise.
- De la diffamation qui englobe toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Par exemple, prétendre sans preuve à la télévision qu’une personne a commis un vol.
- De l'injure qui désigne des propos outrageants ou méprisants, sans lien avec des faits concrets et vérifiables. Un exemple notable est la condamnation de Google Suggest pour avoir associé le nom d'une société au terme "escroc".
Au-delà, des attaques réputationnelles peuvent aussi relever :
- D’une atteinte à la vie privée et au droit à l'image, comme divulguer sans autorisation la présence d'une personne à un événement privé dans un article de presse.
- D’une usurpation d'identité : elle inclut la création de faux profils sur les réseaux sociaux ou de faux sites internet au nom d'une personne, dans le but de perturber sa tranquillité (ou celle d’un tiers) ou de nuire à sa réputation.
- Du harcèlement ou cyberharcèlement qui est constitué par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. À noter que pour lutter contre le cyberharcèlement, l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux est considérée comme une circonstance aggravante de l’infraction. Par ailleurs, et pour lutter contre les phénomène de “meute” particulièrement courant sur le web, de façon assez originale, le cyberharcèlement peut être constitué par des propos ou comportements qui sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée.
Quel droit de réponse à une attaque réputationnelle ?
Si vous êtes victime d’une attaque réputationnelle, vous devez réagir.
Attention, il existe des délais de prescription très brefs en la matière (3 mois à compter de la publication). Ils vous obligent à réagir vite au risque de voir le contenu ne plus être attaquable et de ne plus avoir d’actions possibles.
Outre la riposte communicationnelle ou judiciaire qui pourrait être envisagée (voir l’excellent article sur ce sujet “Comment faire face à un problème de réputation sur les plans techniques et juridiques”), faire usage de son droit de réponse peut être très intéressant.
Le droit de réponse à une attaque réputationnelle : de quoi s’agit-il ?
Le droit de réponse vous permet de rectifier ou de réagir à des propos vous concernant, publiés dans un média ou sur Internet. Il vous offre ainsi l'opportunité de rééquilibrer l'information en présentant votre propre version des faits.
Le fondement du droit de réponse dépend du média concerné :
- Pour la presse écrite, il se trouve à l’article 13 de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- Pour la presse audiovisuelle, il s’agit de l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
- Pour les propos diffusés sur internet, vous devez vous référer aux dispositions de l’article 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
Le droit de réponse est ouvert à toute personne physique ou morale (sociétés, associations, etc.), désignée dans une publication.
En matière de presse écrite, le droit de réponse est très large. En revanche, sur Internet, le législateur a prévu une limite. Si l’internaute est en mesure de “formuler directement ses observations”, il ne peut pas prétendre à un droit de réponse. C’est le cas notamment si les propos préjudiciables sont tenus sur un blog non modéré ou sur un forum de discussion. Dans ce cas de figure, il peut en effet répondre, lui-même, à la personne qui le met en cause.
Concernant la presse audiovisuelle, il existe également une restriction : seuls les propos susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la réputation peuvent faire l'objet d’un droit de réponse.
Pourquoi faire valoir son droit de réponse en cas d’atteinte à sa e-réputation sur Internet ou dans la presse ?
Utiliser votre droit de réponse vous permet de :
- Corriger les informations inexactes diffusées à votre sujet ou au sujet de votre entreprise ;
- Protéger votre image ;
- Empêcher que la situation se dégrade ;
- Rétablir la confiance ;
- Contrôler votre narratif.
Prenons un exemple concret d’atteinte à la e-réputation sur les réseaux sociaux. Une entreprise de cosmétiques est faussement accusée sur TikTok d'utiliser des ingrédients nocifs dans ses produits. En faisant valoir son droit de réponse, cette entreprise peut corriger les faits en présentant des preuves de la sécurité et de la conformité de ses produits. Elle peut également minimiser l'impact négatif de ces allégations sur les consommateurs et sa marque. Ce droit permet donc à l'entreprise de protéger activement sa réputation et de maintenir la confiance de ses clients et de ses partenaires.
Dans un contexte numérique, l’importance du droit de réponse à une atteinte à la e-réputation est décuplée. Quelques chiffres devraient suffire pour vous convaincre :
- 74 % des consommateurs se renseignent sur Google avant d'acheter un produit ou un service ;
- 78 % des consommateurs font confiance aux autres clients pour acheter un produit, contre seulement 16 % à la publicité d’une marque ;
- Lorsqu'un bad buzz survient, 30 % des incidents sont relayés par les médias internationaux dans l'heure qui suit ;
- Si 9 crises réputationnelles sur 10 sont réglées en moins de 72 heures, leur impact est durable. 53 % des entreprises touchées par une atteinte réputationnelle n'ont pas retrouvé leur valeur boursière initiale un an plus tard.
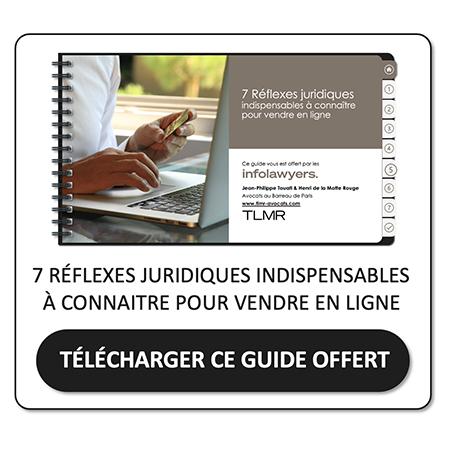
Comment faire valoir votre droit de réponse en cas d’atteinte à votre réputation sur Internet ou dans la presse ?
Vous pouvez adresser votre droit de réponse, de préférence par courrier recommandé avec accusé de réception :
- Personnellement (les personnes morales doivent agir via leur représentant légal) ;
- Par l’intermédiaire d’un avocat.
Les modalités d’exercice de ce droit de répondre à une atteinte à la réputation sont strictement encadrées par la loi. Voici les règles à suivre pour assurer la recevabilité de votre réponse.
- Vous disposez d’un délai de 3 mois à compter du jour de la publication de l’article litigieux (de la diffusion du message audiovisuel ou sur Internet) pour faire valoir votre droit.
- Vous devez adresser votre demande au directeur de la publication à l’adresse du siège social du journal ou à l’éditeur du site internet indiqué dans les mentions légales. En l’absence d’information, la réponse doit être envoyée à l’hébergeur du site.
- La réponse doit être écrite.
- Elle doit être conforme à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
- Elle ne doit pas porter atteinte aux intérêts d’un tiers et à l’honneur du journaliste.
- Son objectif est uniquement d’apporter une réponse aux propos litigieux publiés ou diffusés : votre réponse ne doit donc pas aborder d’autres sujets (arrêt du 30 novembre 2011 de la Cour d’appel de Douai). Il n’est toutefois pas nécessaire de justifier votre droit ou de démontrer l’existence d’un préjudice.
Enfin, le législateur encadre strictement la longueur de votre réponse.
- Pour la presse écrite, elle doit être limitée à la longueur de l’article qui l’a provoquée. Elle peut toutefois contenir cinquante lignes, même si l’article concerné est plus court. Elle ne peut pas dépasser deux cents lignes, même si l’article est plus long.
- Pour une réponse sur Internet, il est indispensable d’indiquer avec précision le message concerné (écrit, sons, image, etc.), ses conditions d'accès et le nom de l’auteur (si celui-ci est disponible). Elle ne doit pas dépasser la longueur du message qui l'a provoquée ou 200 lignes de retranscription.
- Pour une réponse audiovisuelle, le texte ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées et excéder deux minutes.
Quelles sont les modalités de publication du droit de réponse ?
Si la réponse à l'atteinte à votre réputation remplit les conditions de recevabilité énumérées ci-dessus, elle sera automatiquement publiée, et ce gratuitement. L’objectif est de lui assurer une audience équivalente à celle reçue par le message initial.
Pour les réponses par voie de presse écrite
La publication a lieu dans les trois jours de leur réception (24h en période électorale) dans les journaux quotidiens. Pour les autres titres de presse, la publication doit intervenir dans le numéro qui paraîtra le surlendemain de la réception. Cette insertion devra être faite à la “même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation”.
Pour les réponses à une atteinte à la e-réputation
Les délais sont les mêmes en matière d’e-réputation. La réponse doit apparaître à la suite du message en cause ou doit être accessible à partir de celui-ci. Si le message initial n’est plus accessible aux internautes, la réponse doit être accompagnée d’une référence à celui-ci. Elle doit rester accessible aussi longtemps que le message en cause, et au minimum 24 heures.
Pour les réponses audiovisuelles
La réponse doit être diffusée dans les huit jours, dans des conditions techniques équivalentes au message initial, avec une référence précise à ce dernier.
Le défaut d’insertion dans les délais prévu par la loi est puni de 3 750 euros d’amende. Le demandeur a, par ailleurs, la possibilité de solliciter en référé l’insertion forcée de la réponse sous astreinte.
Le droit de réponse est encadré par des règles strictes et doit respecter certaines conditions légales pour être accepté par le média concerné. Il est par ailleurs essentiel d'utiliser ce droit de manière judicieuse. La rédaction de la réponse doit être mûrement réfléchie. Il est également primordial d'anticiper les conséquences de sa publication. Pour toutes ces raisons, le recours à un avocat s'avère indispensable.
Si vous êtes victime d'une attaque sur votre réputation, n'hésitez pas à contacter TLMR Avocats pour obtenir de l'aide et mettre en place les bonnes actions.



