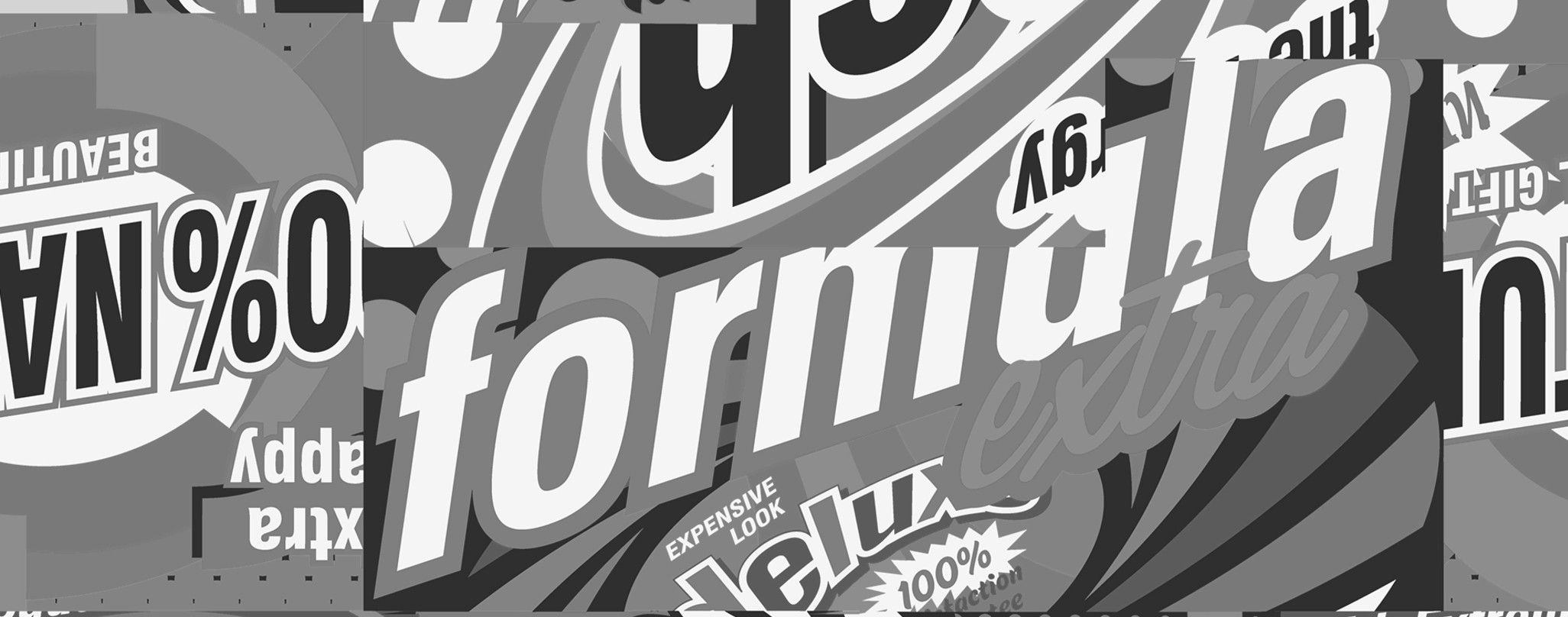Date
13 mai 2025
Par
Henri de la Motte Rouge
La distinctivité des marques en droit français : enjeux et applications pratiques
Partager
La distinctivité constitue une des conditions fondamentales de validité d’une marque en droit français. Explicitement exigée par l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), elle vise à assurer que toute marque déposée remplisse sa fonction première : identifier de manière certaine l’origine commerciale des produits ou services qu'elle désigne, afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du consommateur. Découvrez avec le cabinet d’avocats TLMR la définition de la distinctivité en matière de marques et ses enjeux pratiques et juridiques.
Qu'est-ce que la distinctivité d'une marque ?
Pour comprendre clairement ce qu'est la distinctivité d'une marque, partons de l’utilité même d’une marque commerciale. Une marque sert à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux proposés par ses concurrents. Autrement dit, lorsqu'un consommateur voit ou entend une marque, il doit pouvoir identifier immédiatement d'où proviennent ces produits ou services. C’est précisément cette capacité d’identification qui constitue le caractère distinctif d’une marque.
En droit français, la distinctivité constitue une exigence légale formellement inscrite à l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) :
“Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls : [...] 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif”.
En d’autres termes, une marque qui n’est pas distinctive ne pourra pas être protégée juridiquement. Elle ne pourra donc pas être enregistrée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), organisme chargé d’enregistrer les marques en France.
Ce critère fondamental du droit des marques a été régulièrement confirmé et précisé par les tribunaux et notamment par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Deux arrêts célèbres illustrent parfaitement l’importance de ce caractère distinctif :
- Dans l'arrêt “Hag” du 17 octobre 1990, la Cour insiste sur le fait que la protection juridique d’une marque repose essentiellement sur sa capacité à distinguer des produits ou services. Sans cette capacité distinctive, aucune protection efficace n’est possible.
- Dans l’arrêt “Arsenal Football Club” du 12 novembre 2002, la CJUE réaffirme avec force que la distinctivité est indispensable à la protection d’une marque. Autrement dit, si une marque ne permet pas au consommateur de distinguer clairement les produits qu’elle désigne de ceux d’autres entreprises, elle ne mérite pas la protection que lui accorde la loi.
Pour illustrer concrètement ce principe, prenons deux exemples. La marque “Apple” utilisée pour des téléphones, ordinateurs ou tablettes est très distinctive. Pourquoi ? Parce que le terme “Apple” signifie littéralement “pomme” et n’a donc aucun rapport évident avec les appareils électroniques vendus par l’entreprise. Ainsi, le consommateur associe immédiatement le mot “Apple” à une entreprise spécifique.
À l’inverse, imaginons le terme “baguette” utilisé pour désigner une boulangerie vendant du pain. Ici, le terme “baguette” décrit directement le produit concerné et ne permet pas aux consommateurs d’identifier précisément quelle boulangerie est à l’origine du produit. Une telle marque manquerait clairement de distinctivité et serait refusée à l’enregistrement par l’INPI.
La distinctivité apparaît donc comme le socle indispensable sur lequel repose toute la stratégie de protection et de valorisation juridique d’une marque.
Les différentes formes de distinctivité en droit des marques
Pour aller plus loin dans la compréhension du caractère distinctif des marques, il est important de préciser que le droit français prévoit deux types de distinctivité : la distinctivité dite “ab initio” et la distinctivité dite “acquise par l’usage”. Voyons concrètement ce que recouvrent ces deux concepts juridiques essentiels.
La distinctivité ab initio
La distinctivité ab initio (expression latine signifiant “dès l’origine”) implique que la marque possède, dès son dépôt auprès de l’INPI, une originalité et une capacité immédiate à identifier l’origine des produits ou services proposés. En clair, cela signifie que le signe choisi ne doit pas décrire directement le produit ou le service, ni correspondre à un terme générique ou habituel.
Reprenons l’exemple d’Apple. Dès le départ, cette marque est distinctive car elle ne décrit aucunement les produits électroniques qu’elle désigne (téléphones, ordinateurs ou tablettes). Cette absence totale de lien direct entre le terme choisi et les produits permet immédiatement au consommateur d’associer ces produits à une entreprise spécifique.
Même chose pour la marque “Orange”, employée dans le secteur des télécommunications. Le terme “orange” ne décrit en rien les services de téléphonie mobile ou d'accès à internet proposés par cette société. Il confère donc immédiatement à la marque une distinctivité forte dès son dépôt.
Ainsi, pour assurer une protection optimale dès le départ, il est recommandé de privilégier des signes dits “arbitraires” ou “fantaisistes”, qui n’ont pas de lien direct avec les produits ou services concernés.
La distinctivité par l’usage
Si certains signes manquent initialement de distinctivité, la loi prévoit toutefois qu’ils peuvent acquérir cette qualité progressivement, grâce à une utilisation intensive sur une longue période, accompagnée d'une forte reconnaissance du public. On parle alors de “distinctivité par l’usage”. Ce mécanisme est explicitement prévu par l'article L711-2 alinéa 2 du CPI : le “caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait”.
Cette notion est particulièrement intéressante pour les marques qui étaient initialement considérées comme trop descriptives ou communes, mais qui, grâce à une utilisation massive et prolongée, ont fini par être perçues par les consommateurs comme une indication claire de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service.
C’est le cas, par exemple, de “Booking.com”. À l’origine, cette marque était très descriptive puisqu’elle correspond exactement à l’activité de réservation (“booking” en anglais) d’hébergements en ligne. Lors de son dépôt initial, sa distinctivité n’était pas évidente. Cependant, après des années de forte présence commerciale et publicitaire, la marque “Booking.com” a acquis une réelle reconnaissance auprès du public. Elle est aujourd’hui fortement associée à une entreprise et un service précis.
Cette évolution souligne l'importance d'une stratégie marketing efficace pour renforcer la distinctivité d'une marque initialement faible. Cependant, il est essentiel de noter que cette reconnaissance acquise par l’usage devra être démontrée, preuves à l’appui, devant les tribunaux ou auprès de l’INPI en cas de contestation.
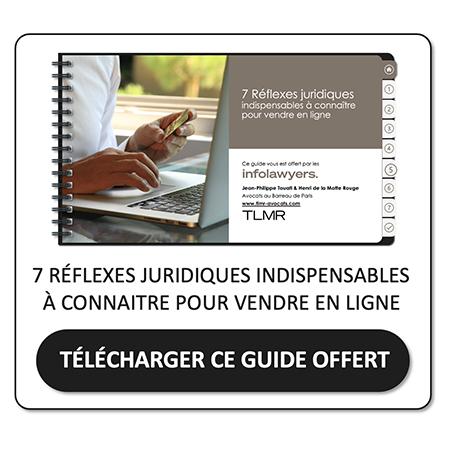
Comment déterminer la distinctivité d'une marque ?
Une fois que l’on comprend ce qu’est la distinctivité et pourquoi elle est essentielle, une question clé se pose : comment apprécier concrètement si une marque est ou non distinctive ?
La réponse n’est pas toujours simple. Elle repose sur une appréciation globale du signe, réalisée au cas par cas, en tenant compte de plusieurs critères dégagés par la jurisprudence française et européenne. Voici les principaux repères qui guident cette analyse.
Le critère de l’impression d’ensemble
Le premier principe à retenir est que la marque doit toujours être appréciée dans son ensemble. Cela signifie qu’un signe composé de plusieurs éléments (mot, logo, couleur, slogan, etc.) ne doit pas être décomposé pour évaluer chaque partie isolément.
Même si certains éléments du signe peuvent sembler descriptifs ou faibles (comme un mot courant ou une couleur simple), l’impression globale produite par l’ensemble peut suffire à conférer un caractère distinctif.
Exemple : une combinaison originale entre un mot générique et un logo graphique singulier peut aboutir à une marque distinctive, là où chacun de ces éléments séparément ne le serait pas.
Le critère du public pertinent
La distinctivité s’apprécie aussi du point de vue du public visé par les produits ou services en question. On parle ici du “public pertinent”. Il peut s’agir du grand public, mais aussi d’un public professionnel ou spécialisé, selon le secteur dans lequel la marque est utilisée.
Il ne s’agit donc pas d’évaluer la marque d’un point de vue abstrait, mais bien à travers les yeux du consommateur moyen normalement attentif et raisonnablement informé, tel que défini par la jurisprudence européenne.
Par exemple, une expression technique, peu connue du grand public, peut paraître distinctive à ses yeux. Elle peut toutefois être considérée comme descriptive dans un secteur professionnel averti.
Le critère de perception du signe par le public
Enfin, pour les marques verbales en particulier, ce qui compte, c’est la manière dont le consommateur va percevoir le signe en lien avec les produits ou services désignés.
Une marque sera considérée comme non distinctive si, au moment de son dépôt, le public la comprend spontanément comme une description du produit, de sa qualité, de sa destination ou de son mode d’emploi. À l’inverse, si le signe ne renvoie à aucune caractéristique du produit et suscite une identification claire d’une origine commerciale, il sera jugé distinctif.
C’est ce qui distingue par exemple un terme comme « ÉcoLinge » (potentiellement descriptif pour des lessives écologiques) d’un mot purement fantaisiste comme « Zalando », dont la signification est absente pour le public et qui, de ce fait, sera perçue comme une marque à part entière.
Les enjeux juridiques et commerciaux liés à la distinctivité d’une marque
On pourrait croire que la distinctivité est un concept purement technique, réservé aux spécialistes du droit des marques. En réalité, elle a des conséquences très concrètes à la fois sur le plan juridique et commercial.
Les enjeux juridiques de la distinctivité
Défendre efficacement sa marque
Le premier effet direct du caractère distinctif d’une marque est de lui permettre d’être valablement enregistrée, puis défendue efficacement en cas de litige.
En pratique, l’INPI rejette très régulièrement des demandes d’enregistrement pour absence de caractère distinctif. C’est d’ailleurs l’un des motifs les plus fréquents de refus. Cette situation peut représenter une perte de temps, d’énergie et d’argent considérable pour les porteurs de projets qui ont engagé une stratégie autour d’un nom qui, juridiquement, ne tiendra pas.
Mais au-delà de l’enregistrement, le caractère distinctif est aussi ce qui permet de faire valoir ses droits contre d’éventuelles contrefaçons sur les réseaux sociaux, par exemple. Plus une marque est jugée distinctive, plus son titulaire aura de facilités à obtenir gain de cause devant les tribunaux. À l’inverse, une marque jugée faible ou descriptive risque de ne pas être protégée contre des signes concurrents trop proches.
Autrement dit, si votre marque n’est pas juridiquement perçue comme forte, vos chances de défendre efficacement vos droits sont limitées.
Utiliser efficacement sa marque distinctive comme levier pour son développement commercial
La distinctivité joue aussi un rôle majeur dans la performance commerciale de votre produit ou service.
Une marque distinctive, parce qu’elle est immédiatement reconnaissable, permet à une entreprise de se démarquer de ses concurrents, de construire une identité forte et de créer un attachement chez ses clients. Elle facilite aussi la mémorisation et renforce la fidélité. Elle peut donc, à terme, devenir un actif immatériel très précieux (valorisable en cas de cession ou de levée de fonds).
À l’inverse, une marque peu distinctive, banale ou trop descriptive, sera noyée dans la masse. Elle aura du mal à imposer une image de marque claire, à se différencier ou à susciter de l’adhésion.
Dans un marché saturé, la capacité d’un nom ou d’un logo à sortir du lot devient une condition de réussite commerciale à part entière.
Comment renforcer la distinctivité de sa marque et éviter sa dégénérescence ?
Vous avez un projet de marque ou vous en exploitez déjà une ? La question n’est pas seulement de savoir si elle est actuellement distinctive, mais comment conserver cette distinctivité dans le temps.
Qu’est-ce que la dégénérescence d’une marque ?
C’est un peu l’effet inverse. Une marque est distinctive mais elle perd au fil du temps ce caractère. On parle alors de dégénérescence. Elle se produit lorsqu’une marque, du fait de son succès, devient un nom commun dans le langage courant. Elle est alors utilisée pour désigner le produit ou le service en général, sans lien avec son origine commerciale.
Quelques exemples célèbres de dégénérescence :
- Frigidaire : autrefois marque d’électroménager, ce nom est aujourd’hui souvent utilisé comme synonyme de réfrigérateur.
- Kleenex désigne n’importe quel mouchoir en papier, peu importe sa marque.
- Velcro, Escalator ou Caddy ont également connu ce sort dans certains pays.
Les solutions pour renforcer la distinctivité d’une marque
Choisir un signe arbitraire, évocateur ou fantaisiste
Le choix du signe est une étape décisive. Pour augmenter vos chances d’avoir une marque forte, renoncez aux termes purement descriptifs ou usuels. Préférez :
- Des mots inventés ou détournés (ex. : Kodak, Xerox).
- Des termes sans lien direct avec les produits ou services.
- Des associations de mots inhabituelles ou métaphoriques (Le Slip Français, Blablacar).
L’originalité linguistique, visuelle ou sonore crée une distance avec la description du produit. C’est cette distance qui crée la force juridique.
Testez vos idées de noms auprès de personnes extérieures à votre projet. Si elles vous répondent : “Ah, donc tu fais des [produits] ?”, cela signifie peut-être que votre marque est trop descriptive.
Travailler la notoriété et la cohérence de votre communication
Une marque peut aussi gagner en force juridique par son usage. Si elle est initialement faible, une communication bien pensée peut progressivement lui faire acquérir de la distinctivité. Pour cela, misez sur :
- Une présence régulière et cohérente (nom, logo, charte graphique, ton de voix).
- Des campagnes de communication ciblées (réseaux sociaux, influence, publicité, relations presse).
- Un ancrage fort dans l’esprit du public, par exemple via un slogan marquant, une mascotte ou un univers visuel distinctif.
Plus le public associe naturellement votre marque à vos produits ou services, plus elle devient identifiable et, donc, défendable.
Exemple : des marques comme « Le Slip Français » ou « Merci Handy », bien que proches d’un langage courant, ont su créer un univers de marque original.
Protéger activement votre marque
Une marque non défendue est une marque affaiblie. Dès l’instant où votre marque est exploitée, vous devez veiller à ce qu’elle ne soit ni imitée, ni banalisée. En pratique, il s’agit :
- De surveiller régulièrement les nouveaux dépôts de marques proches via des outils spécialisés (vous pouvez aussi confier cette mission à un avocat en propriété intellectuelle).
- De réagir rapidement en cas de risque de confusion ou d’imitation : opposition à l’enregistrement, mise en demeure, action en contrefaçon.
- De former vos équipes (marketing, communication, commercial) à l’importance de l’usage correct de la marque et de corriger les usages génériques.
- D’encadrer strictement la manière dont leur marque est utilisée dans la communication externe de votre entreprise.
- De rappeler régulièrement aux consommateurs et aux distributeurs qu’il s’agit d’une marque, et non d’un nom commun.
En agissant rapidement contre les atteintes à votre marque, vous démontrez qu’elle est un actif stratégique pour votre entreprise, ce qui renforce sa crédibilité et sa valeur.
En résumé, la distinctivité d’une marque se construit à la croisée du juridique et du marketing. Le droit fixe les règles du jeu, mais c’est l’usage, la créativité et la vigilance qui font la différence sur le terrain.
Pour protéger votre marque, faites appel à l’expertise du cabinet d’avocats TLMR. Nous disposons d’un savoir‑faire reconnu et d’une excellente maîtrise des enjeux en matière de propriété intellectuelle. Notre cabinet intervient aussi bien en matière de conseil que de contentieux sur tous les volets du droit des marques et accompagne les entreprises dans la sécurisation de leurs actifs immatériels.